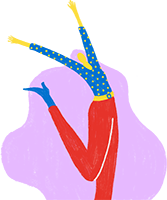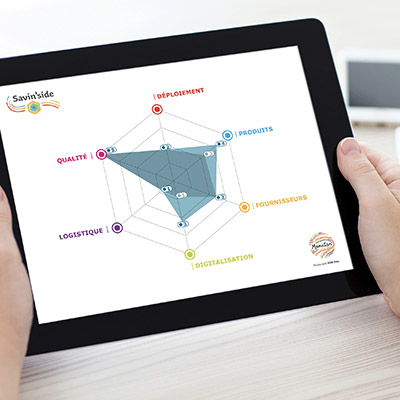De nos jours, les innovations technologiques repoussent les limites du possible et ouvrent la voie à des produits et services toujours plus efficients. Toutefois, cela s’accompagne souvent d’une augmentation de la consommation. Cette réponse comportementale ou systémique fait référence au paradoxe de Jevons, plus connu sous le nom d’« effet rebond ». Ce phénomène est aujourd’hui omniprésent, allant jusqu’à menacer nos efforts individuels, collectifs et politiques en matière de transition écologique, énergétique et circulaire. C’est pourquoi il est important d’en comprendre les tenants et aboutissants pour y faire face.
Qu’est-ce que l’effet rebond ?
L’effet rebond désigne un phénomène d’accroissement de la consommation, lorsqu’on réduit les limites qui étaient jusqu’alors posées à l’usage d’un bien, d’un service ou encore d’une technologie. Les économies supposément attendues sont finalement annulées à travers la surconsommation du produit en question ou la surconsommation d’autres biens. Et pour cause, l’efficacité contribue à développer les usages et les marchés.
Loin d’être nouveau, ce phénomène est décrit pour la toute première fois au XIXe siècle par l’économiste William Stanley Jevons. Celui-ci avait constaté que l’innovation technologique qui améliorait l’efficacité des machines à vapeur n’avait pas réduit la consommation de charbon comme prévu. Cela avait même produit l’effet inverse : les gains énergétiques et financiers avaient généralisé son utilisation et donc participé à accroître l’exploitation de cette source d’énergie.
Lorsqu’il est appliqué au domaine de l’écologie, cet effet rebond semble paradoxal, voire contreproductif. En effet, l’amélioration technique augmente la consommation et la production, ce qui annule (en partie ou totalement) les bénéfices environnementaux attendus. C’est d’ailleurs ce que souligne Louis Daumas, spécialiste en économie écologique et de l’environnement : « On risquerait, en améliorant l’efficacité énergétique des machines, des voitures ou des bâtiments, voire en diminuant le contenu en ressources de la production, de consommer davantage d’énergie et de matériaux, et d’émettre davantage de gaz à effet de serre. Si cela était avéré, alors la transition s’en trouverait encore plus difficile qu’elle ne l’est déjà, voire impossible. »
Cet effet rebond s’applique à chaque révolution technologique. Il s’est manifesté dans différents secteurs d’activité : énergie, agriculture, construction, automobile… Pour ne citer que quelques exemples, cela concerne aussi bien les chauffages performants, les voitures économes en carburant, l’éclairage basse consommation et, plus récemment, le télétravail, l’économie circulaire…
Les différents effets rebond
Les experts distinguent quatre grands types d’effets rebond. L’effet direct et indirect que l’on peut observer à l’échelle d’un agent économique, et l’effet de marché et croissance au niveau de l’économie tout entière.
L’effet direct
Cela se produit lorsqu’on améliore l’efficacité énergétique d’un bien et que cela entraîne une plus grande consommation de ce bien et, ainsi, de son intrant énergétique. Autrement dit, une voiture qui consomme peu de carburant peut inciter le conducteur à rouler davantage.
L’effet indirect
Dans ce cas, les gains économiques issus de l’efficacité énergétique d’un bien rendent possible l’achat d’autres produits, dont la production consomme de l’énergie et pollue. Cela arrive, par exemple, lorsque les économies réalisées grâce une voiture économe en énergie permettent à son propriétaire d’acheter un billet d’avion.
L’effet de marché
Cela reprend l’effet de rebond direct, mais à plus grande échelle. Dans cette configuration, la demande totale d’énergie et de ressource baisse, cela entraîne une baisse de prix et rend certaines activités plus attractives pour lesquelles la demande augmente. On peut, par exemple, envisager un report du fret ferroviaire en faveur du fret routier si ce dernier devient plus intéressant économiquement, car la consommation d’essence au kilomètre diminue.
L’effet de croissance
Dans cette dernière catégorie, l’idée est que toute amélioration de l’efficacité énergétique ou matérielle peut favoriser la croissance économique, mais aussi l’investissement et, ainsi, la consommation d’énergie et de ressources à grande échelle. Aujourd’hui, le secteur numérique est confronté à ce phénomène.
Comment faire face à l’effet rebond ?
Malgré son impact majeur sur l’environnement, l’effet rebond reste peu connu. Fabrice Bonnifet, Président du Collège des Directeurs du développement durable (C3D) rappelle : « Tous les engagements de neutralité carbone ou de réduction de l’intensité énergétique pris par des entreprises ou des États n’auront aucune valeur, ni surtout aucun effet sur la préservation de la planète, tant que la notion d’effet rebond n’aura pas été comprise et prise en compte. ». De fait, peu de solutions sont proposées pour atténuer l’impact négatif des effets rebond. Pour maîtriser ce phénomène en interne, les entreprises peuvent commencer par sensibiliser les collaborateurs et initier des mesures.
Sensibiliser les collaborateurs
Dans l’effet rebond, ce sont nos comportements et nos biais cognitifs en tant que consommateurs qui ont tendance à annihiler une partie des efforts collectifs. C’est pourquoi il est indispensable de prendre en compte le facteur humain. Cela passe immanquablement par une phase de sensibilisation des collaborateurs. C’est d’ailleurs une pratique particulièrement répandue dans le cadre des stratégies énergétiques en entreprise.
Rappelons à ce titre l’importance des plans de sobriété énergétique qui mettent l’accent sur la réduction de la consommation d’énergie à la source, via des écogestes. Cette approche est particulièrement adaptée aux achats simples pour lesquels de nombreux collaborateurs sont habilités à passer commande. À terme, cela doit relever d’une culture d’entreprise engagée envers la consommation durable, incarnée par tous.
H3 – Mesurer l’effet rebond
Comme le veut l’adage : « on ne gère bien que ce que l’on mesure ». Toutefois, l’effet rebond reste complexe à identifier et donc à mesurer. Certains experts se sont prêtés à l’exercice, en comparant différents scénarios à partir de méthodes d’évaluation type : l’analyse du cycle de vie (ACV) ou l’analyse des flux de matières (AFM), les techniques et modèles économétriques, l’estimation du paramètre d’élasticité ou encore les approches hybrides. La plupart d’entre elles se concentrent sur la mesure des émissions de gaz à effet de serre et/ou de la consommation d’énergie.
S’il semble difficile d’appliquer cette approche de façon systématique en entreprise, cela ouvre la réflexion pour des projets stratégiques. C’est à partir de données fiables que les organisations, en collaboration avec les directions achats, pourront mettre en place les stratégiques d’atténuation adaptées.
L’effet rebond reste un phénomène subtil, paradoxal et difficile à appréhender. Il revient aux entreprises de considérer ce phénomène comme une variable essentielle à intégrer dans leurs stratégies de gestion des ressources.