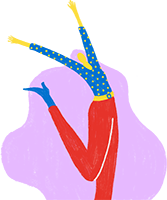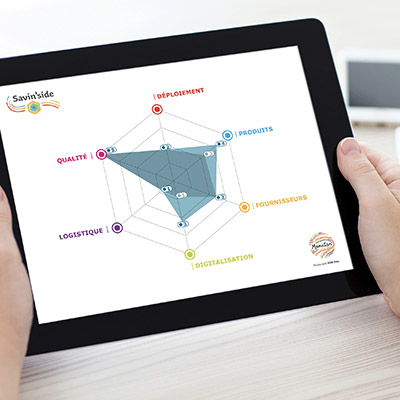Dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe, l’Union européenne (UE) s’est fixé pour ambition d’atteindre l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Pour y parvenir, elle a adapté ses politiques en matière de climat, d’énergie, de transport, d’utilisation des terres et de fiscalité. C’est dans ce cadre que la taxonomie verte européenne a été lancée par la Commission européenne en 2018, puis que le règlement de la taxonomie, son texte fondateur, a été adopté en 2020. Son but : guider et mobiliser les investissements privés vers des activités dites « durables ». Découvrez les fondamentaux de cet instrument réglementaire et comment il influe sur les entreprises.
Qu’est-ce que la taxonomie verte européenne ?
La taxonomie européenne classifie les activités économiques afin de déterminer lesquelles ont un effet favorable sur l’environnement. Ce système a pour vocation de mettre en place un langage commun pour les entreprises et les investisseurs, et leur donner accès à une base de comparabilité. À l’issue de ce processus, l’ambition est d’orienter les investissements vers des activités dites « durables » ou « vertes ».
Une activité économique sera classée comme durable si elle correspond, a minima, à l’un des six objectifs de la finance durable, sans causer de préjudice aux autres objectifs. Elle doit également respecter des garanties minimales en matière de droits humains et de droit du travail tout en se conformant aux critères d’examen techniques définis par les actes délégués.
-
Atténuer le changement climatique ;
-
S’adapter au changement climatique ;
-
Protéger et utiliser durablement les ressources aquatiques et marines ;
-
Faire la transition vers une économie circulaire ;
-
Prévenir et réduire la pollution ;
-
Protéger et restaurer la biodiversité.
-
Les activités durables, qui contribuent directement aux objectifs de finance durable ;
-
Les activités facilitantes, qui accompagnent le développement d’autres sociétés du secteur durable ;
-
Les activités transitoires, qui permettent de réduire l’impact sur l’environnement dans des secteurs où les alternatives à faible intensité de carbone n’existent pas (encore), d’un point de vue technologique ou économique.
Taxonomie européenne : quelles sont les obligations des entreprises ?
Ce cadre réglementaire européen impose à certaines entreprises de mesurer et de rendre transparente la part « verte » de leurs activités ou bien d’un produit financier, soit la partie durable d’un point de vue environnemental.
Dès le 1er janvier 2022, les entreprises de plus de 500 salariés soumises à la directive sur la publication d’informations non financières (NFRD) avaient pour obligation de communiquer des indicateurs de durabilité de taxonomie verte. Ce premier reporting se concentrait uniquement sur les deux premiers objectifs liés à la thématique climat (atténuation et adaptation au changement climatique).
Depuis ce 1er janvier 2024, la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD qui remplace la NFRD) est entrée en application. Cela vient élargir l’obligation de publication de ces fameux indicateurs liés à la taxonomie verte à un plus large panel d’entreprises.
Désormais, elles doivent à la fois indiquer dans quelle mesure leurs activités sont couvertes par la taxonomie européenne (éligibilité), mais aussi se conformer aux critères fixés dans les actes délégués (alignement). Les entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la CSRD peuvent divulguer ces informations de façon volontaire.
De plus, ces nouveaux reportings sur la taxonomie verte devront intégrer quatre nouveaux objectifs, à savoir la préservation de la biodiversité, la protection des ressources marines et aquatiques, le développement de l’économie circulaire et la prévention et le contrôle de la pollution.
L’impact de la taxonomie européenne en entreprise
La taxonomie européenne devrait profondément impacter les entreprises, et ce, de plusieurs manières.
Repenser leur stratégie
La taxonomie européenne est un outil qui oriente la stratégie des entreprises. Elles disposent désormais d’un cadre légal et d’un ensemble d’objectifs à atteindre pour améliorer leurs activités et les rendre plus durables. C’est l’occasion de démontrer clairement leurs engagements en faveur du développement durable.
Attirer les investisseurs
Grâce à cet outil réglementaire, les entreprises peuvent également attirer des investisseurs qui sont intéressés par la durabilité. C’est l’un des objectifs phares de la taxonomie européenne, même si les investisseurs ne sont pas directement pénalisés lorsqu’ils investissent dans des activités qui ne sont pas identifiées comme durables. En développant des investissements verts, il est désormais plus aisé de planifier et de lever des fonds.
Accroître la transparence
À travers un tel reporting, les entreprises sont en mesure de démontrer leurs engagements en faveur de la décarbonation. Cela leur permet d’éviter toute pratique de greenwashing en s’appuyant sur des critères clairs et transparents déterminés par des experts. Cette démarche devrait ainsi renforcer leur image, leur réputation et la confiance de leurs parties prenantes (investisseurs, mais aussi fournisseurs, clients…).
Améliorer ses processus
Enfin, cela permet aussi aux entreprises d’améliorer leur organisation interne. Les indications des critères utilisés dans la taxonomie simplifient la prise de décision et la planification. À terme, elles devraient pouvoir saisir de nouvelles opportunités, tout en améliorant leur gestion des risques.
Vous l’avez compris, la taxonomie européenne est une véritable boussole environnementale. En identifiant les activités économiques durables sur la base de critères clairs et transparents, elle est amenée à jouer un rôle déterminant dans la transformation des entreprises et le développement des marchés de la finance durable. Cela changera notamment la lecture de la performance des organisations pour faire face aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux d’aujourd’hui. En ce sens, elle constitue d’ailleurs le premier lien entre les informations financières et celles extra-financières.